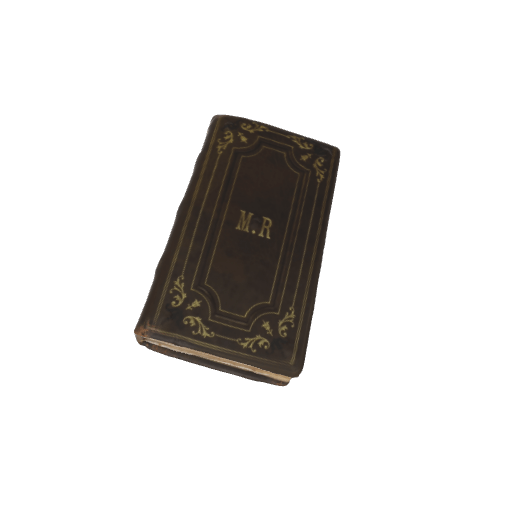Chapitre 9
Progression du peuplement et émergence de l’industrie forestière – Église de Saint-Gabriel, 19e siècle et début du 20e siècle
Entre le début du 19e siècle et le tournant du 20e siècle (période couverte par ce chapitre), les activités économiques se développent au Bas-Saint-Laurent, notamment l’industrie forestière et l’agriculture. L’ensemble du littoral est bientôt occupé par la population d’ascendance européenne, et le territoire habité s’étire maintenant vers les hauteurs du plateau appalachien. Au commencement du 20e siècle, tout le territoire bas-laurentien a été colonisé et fait l’objet d’une exploitation intensive. Dans cette société coloniale, le clergé exerce une forte influence dans toutes les sphères de la vie des individus.
Nous nous retrouvons dans l’église de Saint-Gabriel, un petit village situé derrière Rimouski, à une quarantaine de kilomètres. Construite entièrement en bois en 1903, cette église remplace la première chapelle bâtie en 1872.
Développement économique
À partir du début du 19e siècle, la traite des fourrures perd beaucoup d’importance dans l’économie canadienne, bien qu’elle ne cesse pas complètement. En 1821, un tournant s’opère lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson absorbe sa grande rivale, la Northwest Fur Trading Company. Dès lors, le commerce profite essentiellement aux actionnaires de Londres qui en sont les principaux bénéficiaires. Ce sont alors la coupe du bois et l’agriculture qui prennent la relève pour dynamiser la région. L’industrie forestière tire avantage notamment d’une très forte demande pour le bois de charpente en Angleterre. Depuis l’établissement du blocus continental par Napoléon en 1806, les Britanniques sont incapables d’importer de France et d’Europe le bois dont ils ont besoin pour construire les navires nécessaires à l’unification de leur immense empire « sur lequel le soleil ne se couche jamais ». L’agriculture, quant à elle, profite de l’amélioration des réseaux de communication avec l’ouverture de chemins de colonisation (chemin Kempt, chemin Matapédia, chemin du Témiscouata, chemin Taché) et le développement du chemin de fer. Ainsi, entre 1830 et 1890, des habitants s’établissent un peu partout à l’intérieur des terres, où ils défrichent la forêt et mettent de nouvelles terres en culture.
Formation des villages, cœur des activités
L’arrivée de nouveaux habitants et le nombre élevé de naissances dans les familles contribuent à faire croître rapidement la population du Bas-Saint-Laurent. Dans ce contexte, on voit apparaître des villages aux 19e et 20e siècles, en territoire cantonal, derrière les seigneuries. À la fin du 19e siècle, les sites sont plutôt choisis en fonction de la présence de certaines infrastructures, comme un quai, un moulin ou une église. Dans ce dernier cas, l’histoire montre que plusieurs églises ont été déplacées pour être implantées au cœur de villages naissants. Si un village se construit autour d’un moulin à bois par exemple, c’est là que le centre des activités sera établi, et c’est là que seront bâties les principales habitations. Plus le village grossit, plus la variété des métiers s’accroît. On voit apparaître des moulins à farine, des quais, des chantiers navals et des moulins à bois, des services de vente et de réparation de matériel et d’outils, ainsi que des magasins vendant des denrées alimentaires importées. On voit apparaître les villages de Saint-Antonin, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Michel-de-Squatec, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Sainte-Blandine, Sayabec, Amqui, etc.
Dépossession des terres ancestrales des peuples autochtones
La coupe forestière et l’ouverture de nouvelles régions à la colonisation se font au détriment des populations autochtones, dont les terres n’avaient, jusqu’alors, que peu intéressé la population d’origine européenne. Les Autochtones sont particulièrement affectés par l’industrie forestière, qui les prive de l’accès à leurs territoires de chasse ancestraux et menace la faune et la flore par la destruction des habitats. En quelques décennies, de nombreux moulins à scie apparaissent, et les grandes forêts de pins disparaissent. Les Autochtones n’ont cependant aucun moyen d’empêcher l’exploitation des terres qu’ils occupent depuis des millénaires. Au Québec, en particulier, les gouvernements canadiens et québécois ne leur reconnaissent aucun droit sur leurs terres, contrairement à ce qui est la norme en Ontario, où des traités sont conclus avec les Premières Nations pour acquérir leurs terres.
La drave et les Autochtones
Le mode de vie des Autochtones est aussi affecté par l’utilisation que font les exploitants forestiers des rivières pour transporter le bois depuis le lieu où il est coupé jusqu’aux moulins à scie où il sera débité. Le bois flottant qui s’entasse sur les rivières et à leurs embouchures pollue l’habitat du poisson, ce qui prive les Autochtones de la possibilité de pêcher comme ils le faisaient autrefois. Ceux-ci doivent donc se déplacer vers l’intérieur des terres, en amont des coupes forestières.
Intégration et stratégie d’adaptation des Autochtones
Le progrès de la colonisation et les transformations liées à la coupe forestière et à la drave sur les rivières forcent les Autochtones à modifier leur mode de vie traditionnel et à s’adapter à la cette réalité économique, sociale et environnementale. L’intégration des Premières Nations à cette société est difficile puisqu’on leur refuse de plus en plus les droits reconnus à la majorité des citoyens et parce que l’État refuse de les compenser pour la perte de leurs territoires et de leurs droits de chasse et de pêche. Certaines personnes parviennent à trouver du travail dans les chantiers de coupe, certaines choisissent de chasser et de trapper pour nourrir les bûcherons, alors que d’autres sont engagées comme guides de chasse et de pêche par les riches touristes américains et canadiens qui visitent la région ou encore par les explorateurs et les scientifiques à la recherche de nouvelles ressources à exploiter. Néanmoins, pour la majorité, le fait d’être autochtone rend plus difficile l’obtention d’un travail et surtout, un travail qui soit compatible avec le cycle de vie traditionnel basé sur la chasse et la pêche.
Parmi les stratégies d’adaptation des Autochtones à la nouvelle réalité socioéconomique, on retrouve le développement de l’artisanat qui occupe une place de plus en plus importante dans leurs activités économiques. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les Wolastoqiyik et les Mi'gmaq se spécialisent dans la vannerie, c’est-à-dire la fabrication de paniers tressés à partir de fibres naturelles, notamment de fines languettes (éclisses) de bois, entre autres du frêne. Les Mi'gmaq commencent très tôt à commercialiser ce savoir-faire. Leurs paniers sont prisés par les agriculteurs qui apprécient leur grande solidité et les utilisent pour récolter des fruits et des légumes, comme les pommes de terre. D’abord utilitaires, les ouvrages se raffinent en objets décoratifs et de fantaisie. En 1830, des paniers et des boîtes mi'gmaq sont exportés en Angleterre. Les Wolastoqiyik profitent eux aussi de la forte demande de paniers générée par le développement de l’agriculture dans la région et ouvrent même des points de vente, entre autres à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Kamouraska et à Cacouna. Le développement du système de transport (routes et chemins de fer) et surtout du tourisme augmente les possibilités de tirer profit de cette activité économique. Traditionnellement, ce sont exclusivement les femmes qui fabriquent les paniers et autres articles de vannerie de fantaisie, tandis que les hommes fabriquent plutôt des raquettes et des mocassins. Cependant, plus la production artisanale devient une activité importante dans l’économie des familles, plus les hommes s’impliquent dans les activités autrefois réservées aux femmes.
La réserve de Viger
La réserve de Viger, créée en 1827, est l’une des premières réserves établies au Québec. Située derrière L’Isle-Verte et près de Saint-Épiphane dans la région de Rivière-du-Loup, cette réserve est créée dans le cadre d’un projet-pilote du gouvernement canadien, dont le but est de sédentariser les populations autochtones et de les encourager à devenir fermiers. Cette réserve est destinée à une communauté appelée les Malécites de Viger, qui est toutefois encore très nomade à l’époque et se déplace régulièrement entre la région de Trois-Rivières, le Bas-Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick. Ainsi, le nombre de résidents fluctue grandement selon les années et les saisons. La réserve se révèle davantage un point d’attache qu’un lieu de résidence permanent. Après seulement 43 ans d’existence, la réserve est finalement rachetée par le gouvernement en 1869, à la suite de pressions exercées par la population environnante qui souhaite utiliser les terres cultivables et y exploiter le bois. La cession de Viger entraîne la dispersion du groupe, qui s’intègre discrètement à la population de la province.
En 1876, le gouvernement fédéral achète du gouvernement du Québec une terre de 160 hectares (399 acres) pour les Malécites. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Rivière-du-Loup, cette terre devient la réserve de Whitworth (aujourd’hui appelée Kataskomiq). Une autre réserve, toute petite (soit un demi-acre ou 0,2 hectare), sera aussi créée à Cacouna en 1891, après que le ministère des Affaires indiennes ait acheté un lot de terre situé au bord du fleuve à un certain Timothé Lebel.
En août 2019, réunie en assemblée générale, la Première Nation malécite de Viger décide de se réapproprier son nom d’origine et redevient les Wolastoqiyik Wahipekuk. Le nom « Malécite » avait été donné à cette nation par les colons européens d’après un mot mi'gmaq.
L’Église catholique
Le clergé catholique, en plus d’apporter son soutien moral aux colons, se donne comme mission de convertir les Autochtones, ce qu’il parvient à accomplir passablement bien dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, où de nombreux Mi'gmaqs, Wolastoqiyik et Abénakis deviennent de fervents catholiques. L’influence du clergé s’étend au fur et à mesure que se développent les villes et les villages. À l’époque de la Nouvelle-France, l’Église est représentée essentiellement par les missionnaires, qui visitent les principaux villages à l’occasion des pèlerinages annuels qu’ils font pour se rendre dans les missions autochtones de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick, ainsi que par quelques rares curés résidents. En 1820, on ne compte que quatre prêtres pour tout le territoire qui s’étend de Rivière-du-Loup à Gaspé.
À ces visées religieuses s’ajoutent des responsabilités temporelles. Évêques, curés et congrégations religieuses masculines et féminines jouent un rôle important dans la dispensation de services à la société. L’Église catholique fait construire non seulement des bâtiments consacrés aux célébrations eucharistiques (les messes), mais elle s’implique aussi dans la construction des écoles, des missions, des orphelinats, des hospices, des hôpitaux et des collèges. Les collèges classiques, notamment, qui sont des établissements d’enseignement supérieur, visent à former « l’élite canadienne-française » et à susciter les vocations religieuses. Ces représentants et représentantes de l’Église sont nombreux à y agir comme enseignants, soignants ou administrateurs. Au fil du 19e siècle et jusque dans les années 1950, les congrégations religieuses féminines s’installent partout sur le territoire, jusque dans les paroisses les plus reculées.
Cette présence assidue permet à l’Église d’affirmer ses valeurs et ses normes. Jouant un rôle stratégique dans le développement et la gestion du territoire, évêques, curés, religieux et religieuses s’assurent d’un contrôle sur les mœurs de la population et insistent sur les devoirs religieux de chacun. À l’école, l’éducation religieuse est prioritaire. Il importe de connaître son catéchisme et de faire sa première communion. Au sein des familles, l’influence est majeure : les femmes sont fortement incitées à avoir de nombreux enfants pour favoriser le peuplement. Gare aux couples qui décideraient « d’empêcher la famille »… Dans les territoires de colonisation, les curés s’assurent des bonnes mœurs des nouveaux colons et collaborent avec les gouvernements à la gestion des budgets et de l’allocation des terres.
La dîme
Au départ, les missionnaires bénéficient d’une subvention royale pour participer à la colonisation. À compter du 17e siècle, les propriétaires et les fermiers doivent payer une dîme au curé de la paroisse. Alors qu’en France la dîme était établie à un dixième des récoltes de grains annuelles des habitants, au Québec, elle a été fixée selon les endroits au treizième ou au vingt-sixième des grains. Il s’agit d’une contribution obligatoire au maintien des services paroissiaux et à l’entretien du curé. Dans certains villages, comme à Sainte-Flavie, le curé entrepose les grains ainsi que les différents produits de la ferme – patates, foin, sucre d’érable, bois – des paroissiens reçus en guise de rétribution dans une grange désignée à cet effet. À partir de la fin du 19e siècle, la dîme touche tous les paroissiens, qui s’en acquittent désormais le plus souvent en argent.
Comme c’est le cas pour n’importe quel prélèvement de nature fiscale, la dîme suscite parfois des réticences. Les agriculteurs ont longtemps déploré d’être les seuls à devoir la payer. La dîme n’est généralement pas suffisante pour entretenir le curé. D’autres revenus s’ajoutent, dont le casuel – qui désigne des frais associés généralement à l’exercice de certains ministères comme les baptêmes, les mariages, les funérailles ou les quêtes, ainsi que divers suppléments. Il n’en demeure pas moins que les paroissiens remettent parfois en question les versements qui leur sont réclamés, surtout lorsque les services des sacrements ne sont pas offerts toute l’année, ce qui est le cas lorsqu’un curé n’est pas résident parce qu’il doit visiter plusieurs paroisses en alternance.
Références
DIONNE, Lynda et PELLETIER, Georges. Des forêts et des hommes, 1880-1982 : Photographies du Québec, Les Publications du Québec, Archives nationales du Québec, 1997.
FERRETTI, Lucia. Brève histoire de l’Église catholique au Québec, Montréal, Boréal, 1999.
GORDON, Joleen. « Micmac Indian Basketry », dans Frank W. Porter (dir.), The Art of Native American Basketry: A Living Legacy, New York, Greenwood Press, coll., 1990, p. 17-44.
JAENEN, Cornelius J. Le rôle de l’Église en Nouvelle-France, La Société historique du Canada, Brochure historique No 40, traduction par Marie-France Proulx, Ottawa, 1985.
JOHNSON, Laurence. « La réserve malécite de Viger, un projet-pilote du “programme de civilisation du gouvernement canadien” », mémoire de maîtrise en anthropologie, Université de Montréal, 1995, 272 p.
LAMBERT, Serge et DUPONT, Jean-Claude. Les voies du passé, 1870-1965 : Les transports au Québec, Les Publications du Québec, Archives nationales du Québec, 1997.
LECLERC, Paul-André et SAINT-PIERRE, Jacques. La vie rurale, 1866-1953. Les Publications du Québec, Archives nationales du Québec, 2001.
RADIO-CANADA. « La nation malécite change de nom », audio film du samedi 10 août 2019, avec Amélie Larouche, [En ligne :] https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dessine-moi-un-été/segments/entrevue/127975/premiere-nation-malecite-viger-changement-nom-wolastoqiyik.
ROY, Jean. « La dîme comme prélèvement ecclésiastique », dans Serge Courville et Normand Séguin (dir.). La paroisse. Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Atlas historique du Québec », 2001, [En ligne :] https://atlas.cieq.ca/la-paroisse/la-dime-comme-prelevement-ecclesiastique.pdf.
RURALYS. La conservation intégrée du patrimoine archéologique euroquébécois dans le développement régional : Le territoire du Bas-Saint-Laurent, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, décembre 2007.